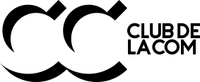Pourquoi écrire sur le féminisme ?
"On oublie toujours que les femmes ont une histoire longue, parce qu'on ne la raconte pas" nous dit l'autrice. Son ouvrage se veut donc être une découverte du féminisme, depuis les pionnières jusqu'à aujourd'hui, à travers les combats pour l'accès aux droits, l'accès à l'éducation, jusqu'à la pleine appropriation de leur propre corps... en passant par l'histoire du poids du patriarcat, de la religion, des institutions pour étudier l'évolution de la place des femmes dans la sphère publique comme privée.
Elle nous rappelle que le mot « histoire » à deux sens : ce qui s'est passé et le récit que l'on en fait. Or, les femmes sont les grandes oubliées de l'histoire car elle a été
« écrite par des hommes, avec un regard masculin occultant les femmes, entraînant silence et l'oubli. L'idée de les réintroduire dans la trame historique n'est pas seulement le fait d'une démarche féministe. C'est d'abord et surtout une revendication de vérité. »
Ceci explique pourquoi l'historienne a décidé de prendre sa plume pour raconter l'histoire et parler de ces femmes déterminées à rompre « les chaînes de la domination masculine et de l'inégalité ». Elle envisage l'histoire comme un outil de médiation du féminisme.
Cet ouvrage fait le point sur les luttes féministes du XXIe siècle à travers différents grands moments, comme les années post-68 ou le considérable #MeToo en rappelant que la question sociale est primordiale pour parler féminisme.
Sa vision est résolument optimiste. De la même manière qu'avant, il était « normal » de battre un enfant, ou d'envisager la peine de mort comme réponse « normale » aux crimes, Michelle PERROT pense qu'un jour des perceptions nouvelles accompagneront le rôle des femmes dans la sphère privée, comme publique. L'un des outils pour avancer est la lutte :
« la protestation, l'action élémentaire, est fondamentale, c'est la preuve physique, matérielle d'un engagement » et « s'approprier l'espace public a toujours été une revendication des féministes ».
À la révolution déjà, Olympe de Gouges affirmait que « les femmes, puisqu'elles montaient à l'échafaud, avaient aussi le droit de monter à la tribune ».
Qu'est-ce que le féminisme ?
Le féminisme est une prise de conscience de la hiérarchie entre les sexes, de ce « déséquilibre ancien et qui perdure. C'est une remise en cause des évidences, des héritages, de cette histoire qu'on a reçue sans réfléchir ». En cela, Michelle PERROT le compare au wokisme qui n'est autre qu'une manière de rester éveillé contre les injustices , le racisme, les discriminations.
Pour bon nombre d'historien·ne, le féminisme est un complément à la démocratie en ce sens où le féminisme dépasse les individualités. Le féminisme est pluriel. Dans son livre, l'historienne développe les questions du milieu social, de la race et de la religion qui viennent donner différentes dimensions au féminisme.
Michelle PERROT rappelle que l'émancipation des femmes est un processus récent, « il a débuté il y a à peu près 200 ans », et la dernière vague date d'une cinquantaine d'années : « qu'est-ce qu'un demi-siècle par rapport aux modèles imposés depuis des millénaires ? »
Aujourd'hui, le féminisme, c'est aussi une réflexion sur le corps. La question du consentement est très récente. L'auteure cite Nicole-Claude MATHIEU qui explique dès 1991 que « accepter n'est pas consentir, céder signifie : je suis contrainte d'accepter ».
Les dates clefs
- 1634 : Création de l'Académie française qui a éliminé le féminin de la langue (exit « autrice » et autres termes en « -esse ») et qui institut que « le masculin l'emporte toujours sur le féminin » !
- 1791 : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges
- De 1804 à 1970 : Le Code civil (de Napoléon) régule le rapport entre les sexes : « le chef de famille à tous les droits, les femmes aucun »
- Révolution de 1848 : La question du droit de vote pour les femmes est abordée pour la première fois
- 1861 : Julie-Victoire DAUBIÉ, première femme à avoir obtenu le baccalauréat
- 1870 : Apparition du mot « féminisme » qui est un terme médical pour qualifier « la maladie des hommes efféminés » ; c'est en 1882 qu'Hubertine AUCLERT retourne cette définition en emblème pour désigner les femmes qui réclament le droit de vote
- 1880 : Loi Camille SÉE où les femmes ont désormais accès à l'enseignement secondaire public
- 1882 : Création de la première école communale gratuite, laïque et obligatoire pour les deux sexes
- 1884 : La loi Naquet établit le droit au divorce
- 1892 : Création du premier lycée de filles
- 1900 : Une loi autorise les femmes à exercer la profession d'avocat
- 1917 : Les midinettes ouvrières des ateliers de couture se mettent en grève
- 1920 : Une loi punit l'avortement (jusqu'alors sanctionné)
- 1922 : Publication du livre « La Garçonne » qui fait scandale et va susciter la mode des cheveux courts
- 1924 : Le baccalauréat devient unisexe
- 1944 : Le droit de vote est accordé aux femmes (elles exercent ce droit dès 1945)
- 1945 : Première femme à devenir magistrat
- 1947 : Marie-Jeanne DURRY, première femme professeure à la Sorbonne
- 1949 : Parution du livre de Simone de Beauvoir « Le Deuxième Sexe »
- 1956 : Création de la Maternité heureuse, qui deviendra en 1960 le Planning familial
- 1960 : Les écoles primaires deviennent mixtes
- 1967 : Légalisation de la contraception
- 1968 : Création du Mouvement de Libération des Femmes
- 1971 : « Manifeste de 343 salopes » pétition de femmes célèbres disant s'être fait avorter
- 1974 : Adoption du projet de loi sur le droit à l'IVG par Simone Veil
- 1975 : Suppression de l'article qui légitime le crime passionnel
- 1980 : Grâce au combat de l'avocate Gisèle HALIMI, le viol devient un crime passible des assises (avant, les violeurs étaient simplement traduits en correctionnelle pour « coups et blessures »)
- 1991 : Première femme Première ministre, Édith Cresson
- 2006 : Création du mouvement #MeToo lancé par Tarana BURKE en soutien aux victimes d'agressions sexuelles à Harlem.
- 2017 : Explosion du mouvement #MeToo par Alyssa Milano qui invite toutes les femmes victimes à partager leur témoignage. Des millions de femmes répondent à l’appel.
- 2017 : Adoption d'une loi en Russie dépénalisant les violences domestiques
- 2024 : Deuxième femme, Première ministre, Élisabeth Borne (33 ans après Édith Cresson)
Slogans et citations
-
« L'absence d'accès à l'éducation est le plus grand crime des hommes envers les femmes », George Sand
-
« Notre corps, nous-mêmes », Mouvement de Libération des Femmes (MLF)
-
« Ne nous libérez pas, on s'en charge », 1970
-
« Un enfant si je veux, quand je veux, comme je veux » 1970
-
« Ni putes, ni soumises », également nom d'une association créée en 2003
Conclusion
Un peu partout dans le monde, des femmes se battent pour leur liberté (Iran, Soudan, Russie, Afghanistan...). Dans les pays occidentaux, les femmes doivent aujourd'hui faire face à « la revanche de l'homme blanc » avec à la tête de ce mouvement Poutine, Kadirov, Orban, Trump... Zemmour en France nous dit que « le féminisme est l'ennemi des pères » et est responsable de la « crise de la masculinité ».
Michelle PERROT nous invite à ne pas oublier que les violences contre les femmes se retrouvent dans tous les domaines « familial, conjugal, gynécologique, politique, sportif, au travail, dans la rue, dans les entreprises, les stades, les médias, les églises, les lieux de pouvoir ».
L'autrice rappelle que l'égalité « est loin d'être gagnée » et « rien n'est jamais acquis, la vigilance s'impose ». Son œil d'historienne sait bien qu'une crise pourrait même remettre en question certains droits péniblement acquis et qu'un retour en arrière est toujours possible...
Zoom sur le masculinisme
Dans un épisode du podcast « Chroniques du Sexisme Ordinaire », Thomas PIET nous éclaire sur ce qu'est le masculinisme. C'est la posture de certains hommes qui valident et prônent les dynamiques de discriminations générées et associent les égalités (et donc les combats féministes) au chaos. Les masculinistes pensent que les femmes cherchent à les dominer, alors qu'il rappelle quand même que :
- les hommes représentent 95 % des dirigeants des entreprises du CAC40
- les hommes gagnent 23 % de plus que les femmes
- les hommes sont coupables de 90 % des crimes violents
L'auteur explique que le masculinisme est dangereux, car il légitime la violence : 24 % des hommes de 25 à 34 ans considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, selon le Rapport 2023 du Haut Conseil de l'Égalité - cela car ils déterminent des stéréotypes de genre où les hommes doivent être violents, dominants, forts et insensibles. Les victimes du masculinisme sont les femmes bien sûr, mais aussi toutes les personnes qui ne sont pas des hommes blancs cisgenres hétérosexuels et correspondant à une certaine idée de la virilité.
Source : https://chroniquesdusexismeordinaire.com/episodes/cest-qui-les-maculinistes