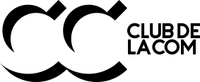Pour les 20 ans de la loi du 11 février 2005 intitulée « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », on souhaitait mettre en valeur trois sujets permettant de mieux comprendre la situation actuelle des personnes handicapées et les politiques d’inclusion.
Handicap : comment s'est construite la politique française
Par Pierre-Yves Baudot, sociologue et politologue, professeur de sociologie à l’Université Paris-Dauphine (IRISSO).
Pour mieux comprendre la situation actuelle des personnes handicapées, Pierre-Yves Baudot revient sur l’histoire des politiques françaises en matière de handicap.
À l’origine de la loi de 2005, il y a une première loi, celle de 1975, qui marque une reconnaissance des droits des personnes handicapées et exige une solidarité nationale en stipulant "la prévention et le dépistage du handicap, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès au sport et aux loisirs [...] constituent une obligation nationale.". Cette loi de 1975 a créé l’AAH (Allocation Adulte Handicapée) qui donne un minimum vital aux personnes handicapées reconnues comme ne pouvant pas travailler.
Puis en 2005, la fameuse loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » est promue et présentée comme un texte de rupture.
Pourquoi ?
La loi française introduit le fait que c’est l’environnement qui produit le handicap, mais cela de « manière timorée » par la formule « le handicap est subi dans son environnement » alors que pour les textes internationaux, le handicap n’est pas « subi » mais « provoqué par l’environnement ». Or « subir » induit l’idée que l’individu n’est pas tout à fait comme les autres et qu’il réalise son handicap quand il est dehors. Les textes internationaux disent au contraire que l’individu est comme les autres, mais que l’environnement (par exemple les marches pour monter escalier) va générer un handicap.
Cette formulation n’a pas remplacé les précédentes définitions du handicap. Aujourd’hui, plusieurs définitions concurrentes du handicap se retrouvent dans le même texte de loi.
Ce texte n’est donc pas aussi ambitieux qu’annoncé, ce qui explique, pour Pierre-Yves Baudot, les « déficits de mise en œuvre ».
Certaines régressions sont même à noter avec des textes de loi en matière de transport, ou de logement qui ont détricoté cette loi de 2005. Un exemple avec l’article 64 de la loi élan de 2018 qui a allégé en imposant plus que 20% de logements accessibles dans la construction d’habitat collectif... au lieu des 100% prévu initialement.
À écouter sur France Culture : handicap : comment s'est construite la politique française ?
Comprendre et lutter contre le validisme
Gildas Bregain, docteur en histoire, chargé de recherche au CNRS à l’École des hautes études en santé publique (laboratoire ARENES) revient sur le terme « validisme ».

Description détaillée de l'image - J'arrête le validisme
- Je demande l'accord d'une personne handi avant de l'aider à se déplacer
- Je ne considère plus les personnes handicapées comme des leçons de vie
- Je dis langue des signes et non langage
- crédit : Les bonnes résolutions du collectif les dévalideuses
Retour sur les jeux paralympiques et leurs impacts sur la perception des personnes handicapées
Pour les spectateurs handicapés, il y avait des problèmes d’accessibilité aux sites des jeux. Contrairement aux jeux de Londres ou de Tokyo, les autorités n’ont pas rendu le métro accessible : « elles n’ont pas profité de l’évènement pour donner un élan majeur à la politique d’accessibilité », regrette Gildas Bregain.
Comment a été véhiculée, diffusée, transmise la perception des personnes handicapées à travers ces jeux paralympiques ?
Les sportifs et sportives ont été parfois glorifiés, mais aussi infantilisés - exemple d’un commentateur télé qui a dit à la championne de Boccia, Aurélie Aubert qu’avec l’argent de sa médaille, elle pourrait s’acheter beaucoup de Kinder Bueno.
Valoriser les athlètes paralympiques à travers leurs parcours de résilience revient à considérer que seules les personnes handicapées qui réalisent des exploits sont dotées d’une humanité. Ce qui laisse de côté toutes les autres personnes qui ne seraient pas productives.
Les publicités sur les jeux ont montré en majorité des images de prothèses, symbole de performance, voire de futurisme et très peu d’autres handicaps.
Le validisme, un concept récemment introduit en France
Le validisme, c’est le nom du système d’oppression que subissent les personnes handicapées à l’instar du sexisme ou du racisme. Cela recouvre une multitude d’actions et de propos discriminatoires, de préjugés, et de violences systémiques basées sur des différences corporelles, psychiques ou intellectuelles. Cela aboutit à une hiérarchisation des individus et contribue à attribuer une plus faible valeur sociale à la vie des personnes handicapées.
Le validisme est une idée qui s’est formée dans les années 70 et formalisée au Canada par une sociologue, Dominique Masson sous le terme « capacitisme ». Puis le terme « validisme » a finalement émergé à la suite d’un consensus entre militant·es, chercheurs et chercheuses.
En France, le terme est apparu relativement tard - 2004 - par rapport aux États-Unis, Grande-Bretagne et Canada parce que les associations gestionnaires du handicap étaient (et pour certaines sont encore) réticentes à utiliser un terme politisé. Il a été poussé par des collectifs militants : Les dévalideuses, Handi-social, Lutte et handicap qui ont popularisé ce concept dans les années 2010.
À l’échelle internationale, il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses qui utilisent ce concept, mais encore assez peu en France. Par ailleurs, un axe de recherche se développe autour de la diversité des validismes (propres à certain handicap). Par exemple, les aveugles peuvent faire l’expérience de l’occulo-centrisme, l’oppression basée sur le fait que la vision est centrale dans la société (situations vécues par les femmes aveugles qui se sont vues refuser leur droit à exercer leur maternité).
L’une des manifestations du validisme est de constater que les besoins des personnes handicapées sont pensés par des personnes dites valides ou que leurs besoins sont secondaires. Par exemple, une commune va dépenser de l’argent pour aménager les routes pour faire traverser le Tour de France, mais ne sera pas prête à dépenser la même somme pour rendre accessible la voirie aux personnes en situation de handicap.
Pour conclure, Gildas Bregain considère que le concept de « validisme » est un instrument politique fort pour faire avancer les politiques publiques du handicap et très utile pour dénoncer le traitement discriminatoire systémique qui génère des freins majeurs dans la vie des personnes handicapées.
À écouter sur France Culture : le validisme selon Gildas Bregain
Pour aller plus loin :
- LSD, La Série Documentaire « La hiérarchie des vies », France Culture
- Dominique Masson, Colloque annuel du RéQEF : Intersectionnalité et capacitisme : enjeux pour la recherche féministe
- Charlotte Puiseux, de chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste, édition La découverte
- Le blog : les dévalideuses